Immortel Saint-Saëns : échos d’un centenaire

En 2021, le centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns avait donné lieu à un certain nombre de manifestations, dont en particulier une exposition marquante à la BnF, et plusieurs enregistrements importants. Ces échos épars, occasion d’évoquer cet immense compositeur français, s’appuient avant tout sur la référence à certains enregistrements, anciens et nouveaux, gage des présences de Saint-Saëns dans la mémoire musicale française.
ALEXANDRE KANTOROW, L’ENCHANTEUR
Il aura fallu quatre cd dont en particulier le multi primé enregistrement des concertos pour piano 3,4 et 5 de Saint-Saëns (Bis, 2022), et de ses triomphes aux Victoires de la Musique, pour diffuser auprès du plus grand nombre ce que savaient déjà, les amateurs de piano : Alexandre Kantorow compte parmi les pianistes les plus doués de sa génération et l’un des musiciens marquants de la jeune génération. Quand on a remporté la médaille d’or et le premier prix du redoutable Concours Tchaïkovsky à 22 ans, la carrière est toute tracée peut-être, mais il fallait encore marquer le public par un enregistrement phare : ce fut le cas, l’année même de cette prestigieuse victoire au Concours Tchaïkovsy (premier lauréat français de l’histoire), avec cd absolument magique, complété depuis (en 2022) par les concertos 1 et 2 du même Saint-Saëns, au nom duquel celui d’Alexandre Kantorow restera associé, c’est sûr.
Ces deux enregistrements ont quelque chose d’addictif : il est difficile de ne pas les écouter en boucle. Et ce n’est que justice, après l’année 2021 qui a marqué le centenaire de Saint-Saëns, dont la renommée mondiale de son vivant (au moment où le compositeur incarnait la musique française dans le monde entier), est certainement inversement proportionnelle à son (très relatif) oubli de nos jours, en tout cas au regard de l’immensité de son œuvre.
Alexandre Kantorow, ici dans le concerto N°2 de Saint-Saëns, avec l’Orchestre de Douai dirigé par son père, l’excellentissime violoniste Jean-Jacques Kantorow (ci-dessous à gauche). Et dans la « Danse macabre » de Saint-Saëns, aux Victoires de la Musique 2019 (ci-dessous à droite) :
Virtuosité éblouissante mais qui n’est pas faite pour éblouir, précision, lyrisme… Alexandre Kantorow, c’est l’excellence, « simplement », c’est-à-dire entièrement, au service de la musique, concrètement, en donnant toute son intelligibilité aux partitions qu’il aborde en vous donnant l’impression que vous y entrez avec lui, comme dans des lieux nouveaux mais où vous pénétrez d’un pas sûr et en ne ratant rien du paysage.
Des concertos pour piano de Saint-Saëns, on connaissait en France l’excellente intégrale enregistrée en 1981 pour Decca par Pascal Rogé et Charles Dutoit (Philharmonia Orchestra / Royal Phlharmonic Orchestra, London Philharmonic Orchestra). Ici, une lecture au moins aussi étourdissante (car Pascal Rogé, autre pianiste surdoué en son temps, avait mis la barre très, très, très haut, il faut le rappeler) et qui a remis le piano de Saint-Saëns et son sens de l’orchestration au centre du monde de la musique d’aujourd’hui. Juste à temps pour qui l’aurait oublié (et ils étaient nombreux) pour le centenaire de 2021. La signature particulière apportée par Alexandre Kantorow, et qui sied tant à Saint-Saëns : un mordant particulier des attaques, une sorte de relief qui emporte l’adhésion dès les premières notes. Et une direction d’orchestre (le Tapiola Sinfonietta) à l’unisson de ce mordant, de la part de Jean-Jacques Kantorow. Quelque chose en somme de plus «sculpté » que dans la version Pascal Rogé. Écoutez ce finale du concerto N° 3 (ci-dessous à gauche), c’est du très grand piano, en trois dimensions et en technicolor ; et le finale du N° 5, « L’Égyptien » (ci-dessous à droite) si orientalisant et si coloré, là encore :
Et la version de ce 5e par Alexandre Kantorow est sublime de bout en bout, impossible d’y résister :
Entrer en Saint-Saëns (comme on entre en religion) par cette porte des concertos pour pianos (et je parlerai aussi dans cette sorte de série, de ses incroyables concertos pour violon), c’est sans conteste entre par la grande porte : tout le percutant et toute l’énergie de Saint-Saëns sont là, et vous empoignent corps et âme.
Des œuvres adulées ou snobées en leur temps (cela dépend des concertos en question), d’une empreinte symphonique marquée et qui, dans le dernier quart du XIXe siècle, participent au renouveau de la musique française alors en cours, avec Fauré, Debussy et Franck. Un plaisir constant d’une musique qui va, comme une force hugolienne bien que d’un rapport distancié au romantisme. Ces concertos, de styles toujours nouveaux, incarnent ce renouvellement du langage : sans être un révolutionnaire, celui qu’on avait dit réactionnaire quant aux formes, fut surtout incompris en son temps, avant qu’on ne puisse correctement évaluer la densité de ses apports. Un piano très lisztien, mais aussi empreint de Schumann, une écriture poétique pour ce fervent du poème symphonique. Des élans irrésistibles.
ITZHAK PERLMAN, L’ALCHIMISTE

Si l’on peut à bon droit considérer le Concerto pour violon N° 3 en si mineur op. 61 (comme un autre illustre « opus 61 » de l’histoire de la musique) comme la pointe affûtée de la production pour violon de Saint-Saëns, et d’ailleurs le plus enregistré de ses trois concertos pour violon, je tiens pour ma part la version qu’en a enregistré Itzhak Perlman pour DG en 1983 avec l’Orchestre de Paris dirigé par Daniel Barenboim, pour la version majeure et la plus impressionnante de ce joyau de la production concertante de Saint-Saëns. Je sais : il y en a tant d’autres… Mais que voulez-vous, je parle certainement de parti pris compte tenu de mon admiration sans borne pour ce violoniste de pur génie, mais là encore, je ne vois pas qui pourrait même supporter la comparaison avec ce relief, cette puissance, cette clarté d’énonciation et bien sûr ce son unique entre tous auquel on reconnaît Perlman parmi une foule d’autres violonistes de premier plan. Ce cd souvent cité en référence du concerto N° 3 de Saint-Saëns est effectivement un chef-d’œuvre de lyrisme maîtrisé et d’une virtuosité intelligemment distillée, dans les trois mouvements de cette sorte de poème symphonique pour violon, à l’image de la Symphonie espagnole de Lalo. Cette recherche de lumière de l’allegro initial, cette cantilène de l’andantino, cette fierté bohémienne du finale : tout cela nous est livré sans détour, le regard de face et sans ciller, par un Perlman maître du chant et de l’émotion.
Ne me croyez pas sur parole, jugez-en par vous-mêmes, au risque du vertige : Allegro non troppo (ci-dessous à gauche) ; Andantino quasi allegretto (ci-dessous au milieu) ; Molto moderato e maestoso – Allegro non troppo – Piu allegro (ci-dessous à droite) :
Je dois dire que j’ai découvert les concertos pour violon de Saint-Saëns bien après le premier choc de l’enfance, énorme, provenu à la fois de son « Introduction et Rondo Capriccioso » et de sa « Havanaise ». Pièces d’abord écoutées avec une passion maladive, pour le coup, jusqu’à l’authentique vertige et même un début de neurasthénie, résolu uniquement en jouant par moi-même (ou en essayant de jouer) ces partitions virtuoses à l’aide de mon professeur de violon, et bien avant de les reprendre par la suite à Paris, à l’École Normale. De cette époque, je sais, non pas par conviction, mais par expérience intime, la fausseté de tous les jugements parfois émis (par des esprits chagrins et peu informés) à l’encontre du style prétendument réactionnaire de Saint-Saëns, reproche en fait adressé tout autant à César Franck ou Gabriel Fauré, les tenants de la recherche de cet « Ars Gallica » qui fondait à la fin du XIXe siècle la quête, en France, d’un renouvellement de l’expression musicale. Je sais, pour l’avoir très profondément éprouvé depuis ce moment clé et fondateur, que cette musique recèle les plus authentiques élans d’un compositeur très loin des poses, et qui écrivit la moindre de ses mesures en accord avec un monde intérieur inaliénable : en somme un vrai musicien.
L’ « Introduction et Rondo Capriccioso » en la mineur op. 28 – que je recommande ici par cette vidéo remasterisée de la version profonde et étourdissante d’Isaac Stern accompagné par le Philharmonia Orchestra dirigé par Eugène Ormandy – est en soi l’illustration de cette musique sans prisme, sans détour. Dès le premier abord, cette « introduction » justement : mélancolie directe, non diluée, et livrée comme telle, en quelques phrases. Le rondo arrive très vite, il est fondé sur des « caprices » en effet, ou variations libres, où même dans ce qui est de plus enjoué, la marque initiale de langueur est encore perceptible. Il s’agit de s’en dégager, et de se livrer certainement à ce que Pascal nommait le « divertissement », mais comme en une conscience supérieure parce que lestée d’une lucidité qui demeure. Alors qu’on ne croie pas ici à un simple exercice de style, pour une pièce dédiée (tout comme le concerto N° 3) au violoniste virtuose des virtuoses de l’époque, l’espagnol Pablo de Sarasate. Ce serait confondre cette musique avec un pur jeu, un pur divertissement précisément, ce qu’elle n’est pas :
Saint-Saëns, pour ce type de quiproquo qu’on développe à son endroit, me semble être le compositeur des malentendus – je veux parler de ceux qui émanent de jugements rapides et à l’emporte-pièce. L’autre pièce courte qui longtemps m’a hanté par sa fausse langueur et son authentique mélancolie « différée » pour encore reprendre le terme de Glissant, est encore de l’ordre de cette musique très pure certainement hors d’accès des étiquettes. Une inspiration exotisante bien sûr, tout comme le 5e concerto pour piano est orientaliste. Il s’agit donc de cette « Havanaise » en mi majeur op. 83, que je donne ici – on ne s’en étonnera pas – encore par Perlman, funambule d’une émotion et de quelque chose qui finit par se clamer sans se calmer. Accompagné par le New York Philharmonic, dirigé par Zubin Mehta en 1987 pour DG.
Car qu’est-ce qui chante là et qui se dérobe ? Qu’est-ce qui oscille entre majeur et mineur ? Qu’est-ce qui est sur une crête, et qui semble « danser vers l’abîme » comme dirait Nietzsche ? Honnêtement, peut-on croire ici à une simple variation de « habanera », qui nous ramènerait à un référent en effet exotique ? Ce serait regarder le doigt quand le sage montre la lune, ce serait donc être l’idiot de l’adage chinois. La Havanaise n’est pas la Javanaise, qu’on se le dise : le violon entonne ici dans l’indescriptible, dans l’évanescent et pourtant présent. On a eu raison d’être attentif, après Jankélévitch, à cette saisie diaphane de l’instant qui envahit l’œuvre de Fauré. Que n’a-t-on été attentif ici à une langueur qui ne veut pas mourir dans la caricature, et qui piège celui-là même qui croyait à une fable exotique, pour le laisser pantois devant un vide qu’on tente de combler. Oui j’ai la faiblesse de percevoir tout cela dans cette pièce apparemment anodine. Faiblesse de l’entendre, très clairement, sans pouvoir en épuiser l’étendue dans la moindre description fidèle.
Nous rendons justice à l’œuvre immense de Camille Saint-Saëns à condition de l’écouter vraiment, hors des préjugés faussés, hors-champs et loin des conventions d’écoute qui ont voulu faire le tour d’une œuvre inclassable, comme le sont celles des très grands compositeurs. Si son centenaire de 2021 a pu servir à quelque chose, c’est de nous mettre en évidence cette réalité : Saint-Saëns est encore un inconnu, et il nous incombe, pour notre bienfait et si nous y consentons, d’apprendre à mieux le connaître, pas à pas. Il est de ces hommes du XIXe siècle (il a d’ailleurs traversé le siècle en quelque façon, né en 1835 et mort en 1921) que l’on croit trop bien connaître surtout en se fiant à leur être social et même à leurs photographies d’époque : bon bourgeois de la IIIe République, compositeur adulé ployant sous les décorations officielles, les plus hautes distinctions de la République et une réputation mondiale qui en fait à l’étranger le représentant de l’art français… la biographie de Saint-Saëns a tout du parcours attendu du compositeur néoclassique dont on ne tarda pas à faire un fieffé réactionnaire. Mais est-on sûr de tout cela ? Tout ce fatras n’est-il pas plutôt une somme de clichés, de ces lieux communs distillés à l’endroit de ces artistes sans doute trop célébrés de leur vivant, mais dont cette célébration même masque la vérité ? À vrai dire, la prétendue « postérité » d’un artiste doit aussi nous rendre humble quant à l’effectivité de la diffusion de son œuvre pour ce qu’elle est et dans son ampleur.
Si je devais revenir sur la production violonistique de Saint-Saëns (et je le dois, pour que mon propos ait une cohérence minimale), je devrais aussi signaler que ses deux premiers concertos sont moins diffusés et enregistrés que le troisième. Je conseille très vivement la très convaincante intégrale de ces trois concertos enregistrée par l’excellente jeune violoniste française Fanny Clamagirand, pour Naxos en 2009, avec le Sinfonia Finlandia dirigé par Patrick Gallois. Ici, Fanny Clamagirand, dans le dernier mouvement de la sonate pour violon et piano op. 102 :
Merveilles pures et serties que ces concertos pour violon N° 1 et 2 (inverses dans l’ordre de leurs composition), avec pour ma part une préférence toute particulière pour la force propre au concerto N° 2 op. 58, dont l’andante est l’une des plus belles pages de Saint-Saëns, tous genres confondus. Fanny Clamagirand présente toutes les qualités requises à mon avis pour bien interpréter Saint-Saëns et notamment cette sorte de « force fragile » (pour ne pas paraphraser la force tranquille), cette puissance indiscutable qui pourtant côtoie les précipices.
CRISTIAN MACELARU, LE RÉNOVATEUR

L’un des bienfaits indéniables d’un centenaire bien mené pour ce qui est d’un grand musicien (et celui de la mort de Saint-Saëns en 2021 le fut, incontestablement), c’est en particulier l’opportunité de nouveaux enregistrements, et j’ai eu l’occasion dans la première partie de mon propos, de citer la version qui désormais fera date des concertos pour piano par Alexandre Kantorow (enregistrements de 2019 et 2022). Parmi les autres moments forts de la discographie, un enregistrement a marqué les esprits à raison, et c’est la nouvelle intégrale de l’œuvre symphonique réalisée par l’Orchestre national de France sous la direction de son nouveau chef depuis deux ans, l’excellentissime Cristian Măcelaru.
On connaissait l’enregistrement qui faisait jusqu’alors référence, de 1975, par l’Orchestre national de l’ORTF (ancienne dénomination de l’ONF) sous la direction de Jean Martinon. Un enregistrement excellent, si ce n’était une prise de son parfois trop réverbérée. Je ne parle pas de l’intégrale de Marc Soustrot, très bonne mais parfois un peu lourde.

Avec la nouvelle intégrale de Cristian Măcelaru, ce véritable massif symphonique a repris bien des couleurs, pour ce qu’il est : rien de moins que l’une des parts essentielles de l’œuvre de Camille Saint-Saëns. Intégrale Warner Classics, 2021.
Si j’ai choisi pour débuter cet article, un portait de Saint-Saëns de 1860 (il a alors 25 ans), cela permettra aussi de rappeler que l’essentiel de ce massif symphonique appartient à la première partie de l’œuvre, à une jeunesse qu’on a dite surdouée, et qui rappelle le météore Mendelssohn. Car oui, l’invraisemblable précocité de Saint-Saëns nous rappelle aussi que nous avons certainement bien du mal aujourd’hui à envisager de tels réalités, en dehors des phénomènes de foire de ce qu’on nomme « enfants prodiges ». Je veux dire que bien des hommes du XIXe siècle, nés dans des contextes sociaux et culturels à des galaxies de notre temps, ne peuvent certainement pas être appréhendés avec les critères d’aujourd’hui, au risque d’avoir le vertige, pour ce qui est de l’ampleur de leur œuvre et du concentré de leur existence.
On a certainement un problème d’échelle, c’est sûr : comment concevoir que les premières œuvres de Saint-Saëns sont composées à l’âge de TROIS ANS ET DEMI ? Ou que (je cite Marie-Gabrielle Soret, « Saint-Saëns de A à Z », « Diapason » novembre 2021) « à cinq ans il apprend avec délices les subtilités de l’instrumentation dans la partition d’orchestre de Don Giovanni qu’on lui avait offerte » ? Ou qu’à dix ans il donne son premier concert à Pleyel ?
Revenons-en aux cinq symphonies : deux d’entre elles mais ne sont pas numérotées. Elles ont été ajoutées à son catalogue symphonique à la faveur de recherches musicologiques du début des années soixante-dix. Ces œuvres de jeunesse (les symphonies en la ; N° 1 en mi bémol op. 3 ; en fa « Urbs Roma » et N° 2 en la mineur) sont composées entre l’âge de 15 ans et 24 ans. Ce sont de pures merveilles, les deux premières très classiques mais avec déjà ce souffle particulier qui va, je crois éclater définitivement par « Urbs Roma », où le jeune compositeur chante la grandeur déchue de la Rome antique. Ici, dans l’excellente version, justement, de Jean Martinon :
Mais tout le monde s’accorde à reconnaître, à juste raison, que le chef-d’œuvre symphonique de Saint-Saëns, c’est sa Symphonie N° 3 avec orgue en ut mineur op. 78. On peut le dire sans hésiter, le génie orchestral de Saint-Saëns connaît là son apogée. Un Saint-Saëns de la maturité (l’œuvre est de 185-1886) qui fait place à une élévation spirituelle considérable, qui me rappelle Bruckner. Sentiment de l’absolu, tension vers le sublime, omniprésence des accents du Dies Irae… et puis cette puissance ineffable du final où l’orgue déploie l’immensité de son timbre. Et quand cet orgue est servi par Olivier Latry, titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris (qui renaîtront), on est, il faut le dire sans sourciller, dans un tel accomplissement qu’on ne pouvait pas rêver mieux pour marquer à jamais un centenaire. Sentiment de grandeur, d’écrasement devant le sublime, et de respiration restituée. Cette symphonie grandiose sans jamais être grandiloquente, par l’orchestre de Paris sous la direction de Paavo Järvi, avec à l’orgue Thierry Escaich :
On ne s’étonnera pas que Karajan, au soir de sa vie, se soit penché sur les accents amples et le souffle unique de cette symphonie. Il en a enregistré pour DG une version superlative avec le Philharmonique de Berlin et Pierre Cochereau à l’orgue, dont j’indique ici quelques ressources YouTube :
Une chance assez inouïe, finalement, que se soit justement au moment où l’ONF dispose de l’un des meilleurs chefs de son histoire, et d l’un de ses organistes les plus marquants, qu’on ait pu ainsi disposer en 2021, de l’intégrale qui nous rappelle ceci, qu’on avait peut-être oublié : en son temps, Saint-Saëns fut l’un des symphonistes majeurs qui réussit à adjoindre la musique française à la grande tradition de la symphonie romantique, en prenant en quelque façon la suite de cette tradition, transcendée dans son cher « Ars Gallica ».
ŒUVRE-MONDE ET CENTENAIRE

Fort heureusement (car je crois qu’il faut plutôt s’en féliciter que de rechigner), les grandes majors de l’industrie du disque ont pris l’habitude de marquer les célébrations liées à la postérité des compositeurs, par la sortie d’énormes coffrets reprenant les enregistrements de leurs catalogues. Il vaut mieux juger sur pièce, car si l’intention est louable (même si elle repose aussi sur des considérations commerciales), ces initiatives peuvent relever soit du recyclage, soit de belles mises en perspective éditoriale. Dans le cas de l’imposant coffret Camille Saint-Saëns publié par Warner Classics à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur en 2021, je crois qu’on peut le dire : il s’agit là d’une belle réussite et qui plus est, d’un bel instrument de diffusion au service de cette postérité longtemps problématique d’une œuvre considérable. Car c’est bien cette prise en compte de la globalité de cette œuvre que permet une telle réalisation : nous remettre devant les yeux à la fois la diversité et l’ampleur du catalogue Saint-Saëns. Comme le rappelle l’une de ses meilleures spécialistes, Marie-Gabrielle Soret (Diapason de novembre 2021), pour lui qui proclamait volontiers « Je fais de la musique comme un pommier produit des pommes », pas un seul genre musical dans lequel ce boulimique de création ne se soit brillamment illustré, mis à part peut-être le piano seul, tant il a préféré faire dialoguer son instrument avec l’orchestre ou dans le cadre de la musique de chambre : « Œuvres pour instruments solistes, musique de chambre, symphonies, concertos, mélodies, cantiques, cantates, hymnes, odes, messes, chœurs, requiem, musiques de scène, oratorios, opéras… : il n’est pas un genre que Saint-Saëns n’ait abordé. »

Je trouve en ce qui me concerne à la fois rassurant, juste et « rafraîchissant » que les musiciens français d’aujourd’hui, à la faveur de ce centenaire, aient pu prendre l’initiative de se saisir à neuf de la musique de chambre foisonnante de Saint-Saëns. En dépit des restrictions dues à la pandémie et de la fermeture temporaire des salles de concerts qui se sont produites durant ce centenaire de 2021, cet intérêt est réel et continue de se manifester ; cela désigne sûrement un « effet centenaire » qui a joué à plein, mais dans le bon sens, celui de la transmission d’œuvres qui avaient besoin d’être à nouveau enregistrées et programmées dans les salles. Dès 2020, Erato sortait un très beau cd des sonates et trios de Saint-Saëns par Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou et Edgar Moreau. L’excellence d’un esprit français, d’un touché habitué aux volutes diaphanes de Fauré et Debussy, mais qui justement a pu être savamment redéployé dans ce lyrisme si personnel du « Beethoven français » comme certains aiment à désigner Saint-Saëns.
S’agit-il pour autant de se montrer étroitement cocardier quand il s’agit d’un compositeur qui a porté si loin et si longtemps la trace de la musique française ? Certes non, car la francité de Saint-Saëns n’a jamais consisté en un enfermement nationaliste sur un style prétendument atavique. S’il a fait en sorte, au gré de ses multiples activités, de faire redécouvrir des pans entiers du répertoire français ancien (on lui doit la première édition scientifique complète des œuvres de Rameau, chez Durand), il faut y voir surtout la manifestation à la fois d’une consternation devant la longue négligence du répertoire français et de sa volonté de contribuer à y mettre fin. Dans son article, Marie-Gabrielle Soret met en avant deux citations éloquentes du compositeur sur ce point. En 1874, il écrit : « Personne ne songeait à notre vieille École française. De Lully, on ne connaissait que le nom ; les Campra, les Mondonville et autres étaient complètement ignorés ; et de Gluck lui-même, que savait-on ? On l’avait oublié. Les partitions d’orchestre de la première édition – introuvables aujourd’hui, – se vendaient cinq francs sur les quais. De Rameau, on ne parlait jamais. » Et puis encore, ce constat terrible, quand il note que jusqu’à la constitution par ses soins en 1871 de la Société nationale de musique, en France les organisateurs de concerts « n’admettaient sur leurs propres programmes que les noms resplendissants de Beethoven, Mozart, Haydn et Mendelssohn, quelquefois Schumann, pour faire preuve d’audace. Le nom d’un compositeur à la fois français et vivant imprimé sur une affiche avait la propriété de mettre tout le monde en fuite. »
On ne le réalise pas, mais le corollaire de ce constat et des efforts institutionnels déployés par Saint-Saëns, à l’appui de sa propre carrière, c’est que la génération qui le suivra immédiatement, celle des Fauré, Debussy, Ravel (à laquelle il fut si opposé), va directement bénéficier de cette véritable « défense et illustration » de la musique française à laquelle il s’est inlassablement prêté, comme naguère Du Bellay l’avait fait pour la langue. Car l’écrasante prédominance des compositeurs et des traditions musicales germaniques jusqu’à cette fin du XIXe siècle est une réalité massive, qu’on a peine à se figurer aujourd’hui. C’est en partie en réaction à cet état de fait qu’émergeront dans le dernier quart du siècle et dans toute l’Europe ce qu’on nommera les « écoles nationales » qui marqueront tant l’histoire de la musique.

Grâce à sa longévité, cet homme aura traversé tout le XIXe siècle, et aura côtoyé Liszt tout en étant bien plus tard le contemporain de Debussy et Fauré, qui fut son élève à École Niedermeyer. Et avant de voir dans la figure du Saint-Saëns des dernières années, qui atteint les deux premières décennies du XXe siècle, ce représentant souvent décrié (en dépit même de son exceptionnelle notoriété) d’un style néoclassique désuet, on ferait mieux de se rappeler cet office irremplaçable qu’il a su jouer à la fois dans le renouveau et la diffusion du « style français » en musique. C’est pourquoi (les travaux qui ont émergé à la faveur du centenaire l’ont rappelé), quand le wagnérisme déferle sur la France dans les années 1870, ce n’est pas tant par esprit nationaliste que Saint-Saëns y résiste coûte que coûte (lui qui fut l’un des premiers défenseurs de Wagner en France), que par la volonté de ne pas s’enfermer dans une idéologie – et Marie-Gabrielle Soret rappelle ces mots du compositeur : « J’admire profondément les œuvres de Richard Wagner, en dépit de leur bizarrerie. Elles sont supérieures et puissantes, cela me suffit. Mais je n’ai jamais été, je ne suis pas, je ne serai jamais de la religion wagnérienne. »
LES BILANS D’UN CENTENAIRE

C’est en somme cet « esprit libre », que le centenaire de 2021 a permis de faire revivre, à travers les multiples initiatives qui en ont marqué la commémoration, à commencer par cette remarquable exposition menée par la BnF au Palais Garnier, dont le tire était justement Saint-Saëns, un esprit libre (pérennisée par un excellent catalogue).
Il fallait appeler en somme ce que fut cet artiste curieux de tout et dont plus exactement la curiosité intellectuelle semblait ne connaître aucune limite : « Compositeur, interprète, acteur de la vie musicale, Saint-Saëns est aussi journaliste, chroniqueur, critique musical, poète, auteur d’écrits philosophiques, d’essais et de pièces de théâtre. » (Marie-Gabrielle Soret, op. cit.). il faut aussi ajouter : voyageur passionné. À l’occasion de ses nombreuses tournées ou en dehors même de son activité de musicien, Saint-Saëns a passé une bonne partie de son temps sur les mers, vers les États-Unis, l’Égypte, l’Algérie, bien sûr la plupart des pays européens, etc. Un appétit du monde que là encore, on a voué trop facilement au besoin de soigner sa tuberculose chronique, ou encore à sa soif d’orientalisme. Non, Saint-Saëns a une inextinguible curiosité du monde qu’on retrouve sans peine dans sa musique si on sait l’écouter.
Ce goût de l’ailleurs le sauve aussi du piège de la mondanité et du parisianisme dans lequel il aurait été si facile de s’enfermer, pour un musicien si célébré de son vivant. Car sans doute la lassitude, sans doute le chagrin de la mort de ses deux fils, et celui d’un mariage raté, font qu’un beau jour de 1890, Monsieur Saint-Saëns, multi-décoré de la République, musicien adulé… va mettre les voiles, sans laisser d’adresse. Pendant plusieurs mois, la presse se fait l’écho de « la disparition de Monsieur Saint-Saëns ». Rien n’y fait : le voyageur a pris le dessus. Il est parti. Sans prévenir. Et il revient, idem, sans prévenir, n’ayant de compte à rendre à personne, et surtout pas aux mondains. Saint-Saëns est fatigué, en cette période, qu’après avoir été si encensé, il soit devenu la proie de certains « modernistes » qui crient au réactionnaire en entendant sa musique, en trouvant qu’elle est trop jouée et qu’il ferait mieux de faire place aux jeunes. Car il n’a cessé, lui, de faire place aux jeunes musiciens, compositeurs et interprètes, tout au long de son itinéraire qui fut à l’opposé de celui d’un carriériste.
En cette fin de siècle et surtout en ce début du XXe siècle, une certaine indistinction, mais aussi la précipitation des avant-gardes s’abattent sur ce qu’elles croient être d’un temps révolu. L’idéologie a pris le pas sur l’appréciation d’une œuvre pour ce qu’elle représente d’unique. Saint-Saëns fait donc un pas de côté. Puis deux, puis trois. Il n’est pas de ceux qui s’accrochent à leur rochers, sinistres laminaires du calcul qui pullulent dans les couloirs du Conservatoire ou de l’Institut. Sa musique, elle, est écrite aussi pour être redécouverte par une postérité qui saura lui rendre son tribut.
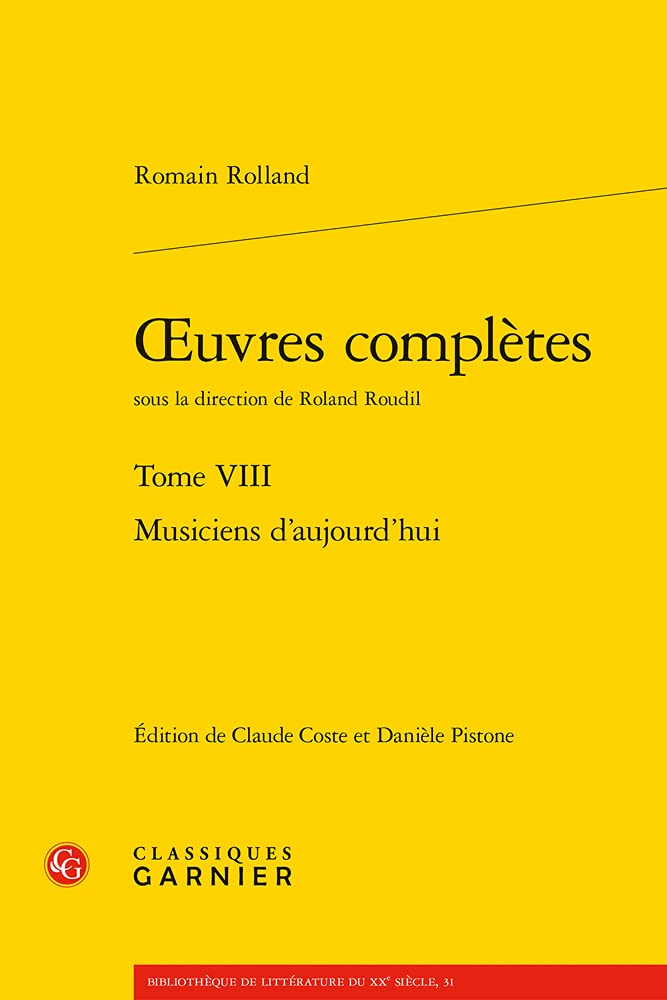
Dans les nombreuses études sur les « Musiciens d’aujourd’hui » publiés par Romain Rolland au tournant du siècle et remarquablement rééditées par Classiques Garnier en 2021 par Danièle Pistone et Claude Coste, on lit ceci, qui définit bien je crois, l’attitude d’indépendance farouche que manifesta constamment Camille Saint-Saëns : « Personne n’a jamais été aussi indifférent aux faveurs de la foule comme de l’élite. »
Esprit libre, résolument. Artiste qui a suivi sa voie, en pensant avant l’heure qu’à le regarder, les autres se seraient habitués. Son « Carnaval des animaux » (œuvre de circonstance qui connut un tel succès de son vivant qu’il redouta qu’on le réduise à cette pièce) se rappelle à l’esprit des Français chaque année, qu’ils en soient conscients ou pas : lors du Festival de Cannes, l’un des morceaux fétiches des cérémonies d’ouverture et de clôture, c’est « Aquarium » issu de cette suite magique que demeure le « Carnaval des animaux » de Saint-Saëns.
Que la musique de ce créateur passionné, de cet esprit libre et de ce démiurge d’une musique aussi sublime, soit devenue l’hymne d’un festival du cinéma, c’est finalement à la fois un symbole et une ironie de l’histoire. Car Saint-Saëns, contemporain des frères Lumière, fut en fait le tout premier compositeur du cinéma : en 1908, il signe la toute première musique de film du cinéma muet, pour André Calmettes et Charles le Bargyilm, « L’Assassinat du duc de Guise ». Très beau clin d’œil en effet, que ce salut annuel et fraternel par le monde du cinéma, à celui qui fut l’inventeur d’univers sonores uniques. Une incitation, peut-être, à rejoindre ad libitum le maître des enchantements, en ses voyages recommencés.
